Thomas de Quincey — Les derniers jours d’Emmanuel Kant
Dans ce livre encore méconnu par rapport au reste de son œuvre, Thomas de Quincey relate avec un souci de vraisemblance déconcertant la fin de vie de l’un des plus grands esprits de son temps, Emmanuel Kant, au travers de la narration fictive de son contemporain Wasianski. Mais derrière l’apparence du faux témoignage biographique s’y esquisse en fait une peinture à la fois chirurgicale et iconoclaste de la vieillesse comme déliquescence.
Billet écrit en partenariat avec La-philosophie.com.
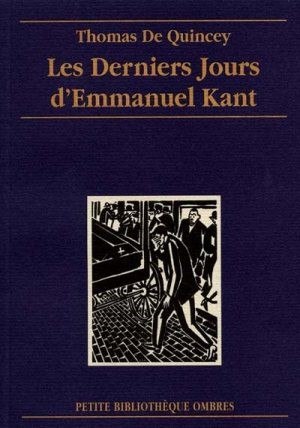
Difficile tout d’abord de ne pas dévorer ce roman avec une « curiosité éclairée » pour quiconque s’est approché de près ou de loin de la philosophie : en choisissant comme sujet la fin de la vie d’Emmanuel Kant, Quincey s’est délibérément attaqué à un monument sacré. Pour les étudiants en sciences humaines, le simple nom de Kant évoque une espèce de monstre conceptuel, dont le système philosophique avait la prétention de rendre compte de la totalité du réel et dont l’influence a profondément marqué l’histoire des idées. Et quand on en vient à la personne que pouvait bien être, dans sa vie quotidienne, le penseur de Königsberg, Kant a l’aura d’un pur esprit pour lequel on imagine une vie quasi monastique, morne et réglée sous tous ses aspects.
Un Kant en chair et en os
C’est là le premier facteur qui permet à de Quincey de captiver son lecteur : il joue sur une image fantasmée, celle de l’existence ascétique d’un homme entièrement dévolu au travail intellectuel et à son œuvre colossale, mais nous fait bientôt découvrir une humanité et une personnalité attachante. Sous sa plume, cette icône habituellement figée dans la « pureté et la dignité philosophiques » nous apparaît enfin de manière tangible et l’on se retrouve en fait en présence d’un personnage presque attendrissant.
Dans la première partie du récit, on découvre d’abord un grand universitaire de son temps qui, s’il vivait certes selon ses propres préceptes et d’une existence apparemment sévère, n’en était pas pour autant reclus sur lui-même ni dépourvu d’une certaine grâce. Quincey donne à voir un homme bien vivant, entouré d’amis et qui apprécie d’une manière tout épicurienne les plaisirs de la table et de la conversation.
On y découvre également un Kant s’inquiétant autant de son corps que de son esprit, entretenant pour son hygiène de vie des habitudes souvent loufoques et dénotant une certaine hypocondrie. C’est pourtant par ces habitudes que le narrateur et Kant lui-même s’expliquent l’âge avancé auquel il parvint, tel un gymnaste, sans jamais cesser de jouir d’une santé de fer.
Même les génies meurent
La vieillesse, pourtant, arrive bientôt pour devenir le sujet essentiel du récit. Et quel meilleur exemple que celui de Kant, un homme dont l’intelligence était si puissante, respectée et admirée de tous, pour décrire avec une effrayante précision, tant chronologique que clinique, le lent et inexorable déclin des facultés mentales qui l’accompagnent ?
On la voit d’abord s’installer au travers d’anecdotes qui seront familières à tous ceux qui ont accompagné des personnes âgées et qui peuvent rappeler les prémices d’un syndrome d’Alzheimer : perte de la mémoire immédiate, radotages, érosion de la notion du temps... Bientôt, la vieillesse de Kant apparaît comme un retour progressif vers l’enfance, une sortie de l’âge de raison. Lui qui ne se laissait jamais aller à aucun relâchement dans sa conduite se montre désormais capricieux : entre autres exemples, on le voit ainsi développer une petite addiction au café qui donne lieu à des scènes plutôt comiques avec ses domestiques.
Avec minutie et précision, Quincey relate la lente décrépitude, à la fois mentale et corporelle, d’un génie qui fut pourtant l’un des plus imposants de son temps. Tout au long de cette exposition apparemment scrupuleuse des symptômes de la sénilité, le décalage avec l’esprit excellent et infaillible par lequel on se représentait jusqu’alors le grand philosophe prend un tour tantôt ironique, tantôt pathétique.
« Quincey prend donc le contrepied à la fois lucide et pessimiste d’une tradition qui, de Cicéron à Montaigne, a voulu vanter les avantages de la vieillesse : dans Les derniers jours d’Emmanuel Kant, celle-ci est décrite au contraire comme ce qu’elle est cliniquement, c’est-à-dire une perte irréversible de puissance. »
On le voit peu à peu se recouvrir de ténèbres, s’égarer dans des fantasmagories et des hallucinations qui inspirèrent une exposition à l’artiste Laurent Millet. Jusqu’à la description presque clinique de son agonie, de ses derniers battements de pouls et de l’arrêt complet du mécanisme corporel : le récit devient alors assez crû, presque naturaliste pour nous rappeler la décrépitude à laquelle même les esprits qui se sont élevés au-dessus des autres ne peuvent échapper.
Est-ce à dire pour autant que Thomas de Quincey a voulu briser une idole en montrant à quel point elle était mortelle ? Pas vraiment. Tout au long de ce récit désolant de la déliquescence d’un homme, il laisse paraître les éclairs de lucidité au cours desquels Kant prouvait, jusqu’à la toute fin, la conscience qu’il avait de son propre état. Il nous laisse voir lors de nombreux passages que la flamme, jadis si haute de son intelligence est toujours là, à l’état de braise, mais encore brûlante.
Il a plutôt cherché à nous rappeler, dans un constat implacable, mais pas dénué de tendresse, que l’intelligence humaine, même élevée au plus haut point comme elle l’était chez Kant, n’est jamais divine. Il a simplement noté le moment ou l’esprit faillit et n’est plus capable de théoriser, celui qui marque le début d’une longue perte des facultés cognitives, sensitives et rationnelles avec laquelle il faut pourtant continuer à vivre jusqu’à la fin. Quincey prend donc le contrepied à la fois lucide et pessimiste d’une tradition qui, de Cicéron à Montaigne, a voulu vanter les avantages de la vieillesse : dans Les derniers jours d’Emmanuel Kant, celle-ci est décrite au contraire comme ce qu’elle est cliniquement, c’est-à-dire une perte irréversible de puissance.
Voir en ligne : Lire l’article sur ActuaLitté
