- PDF - 189.9 kio
- "Progressistes" et "conservateurs", qu’est-ce à dire ?
- Qu’est-ce que le rapport Derrida-Bouveresse ?
- Pourquoi les sociologues se mêlent-ils de nos questions ?
Notes à l’appui du débat en ligne.
"Progressistes" et "conservateurs", qu’est-ce à dire ?
J’appelle conservateurs les professeurs qui se sont opposés aux réformes de notre enseignement quand celui-ci a été confronté à l’arrivée dans ses classes de toute cette jeunesse qui, avant la démocratisation de l’école, en était exclue. Certains conservateurs revendiquent explicitement une position élitaire (la philosophie ne sera jamais faite pour la masse) ; la plupart admettent qu’elle a vocation à adresser à tous, mais à condition que l’école leur livre des élèves capables de suivre l’enseignement de la philosophie tel qu’il a été conçu dans le contexte du lycée élitiste des années 60, en d’autres termes : « d’accord pour changer, si rien ne change en philosophie ». [1]
Les conservateurs se battent pour maintenir le modèle d’enseignement de l’ancienne « classe de philosophie », un enseignement élitiste, institué pour les « élites » sociales et fonctionnellement ordonné à leur reproduction. La « classe de philosophie » n’a jamais concerné - en effet - que 1% d’une classe d’âge en 1900, à peine 2% en 1925, 4,5% en 1945 et 7% au plus dans les années 60-70. Constatant l’impossibilité de continuer à enseigner comme avant, les conservateurs concluent à l’échec de la démocratisation. Ce sont des élitaires.
Beaucoup d’entre eux disent à mi-mots qu’il est impossible d’enseigner dans ce lycée-là avec ces élèves-là ; d’autres assument clairement leur position, comme Jean-Louis Thiriet en ce matin de 1999 :
Je suis pour la fin de l’enseignement de la philosophie dans les conditions actuelles avec les élèves tels qu’ils sont ; je ne vois pas comment on pourra continuer à mener cet enseignement avec les élèves tels qu’ils sont.
Je pense que les élèves n’arrivent pas à s’élever aux problèmes philosophiques, et par là même, aux règles de la dissertation, car, qui ne comprend pas la philosophie, ne peut pas comprendre comment on fait une dissertation. [2]
Les conservateurs n’acceptent donc pas la démocratisation sociale du lycée.
J’appelle, à l’inverse, progressistes, les professeurs qui soutiennent la démocratisation sociale du lycée. Ce sont des égalitaires. Le progressiste sera en désaccord avec un élitaire assumé ; il lui reconnaîtra le mérite de sa cohérence et la liberté de son choix. Le problème vient des élitaires honteux (ou inconscients ?) qui, sous couvert d’égalité, défendent une pédagogie élitiste, ce qui est le cas de la majorité des conservateurs.
Les progressistes conscients que l’enseignement de la philosophie doit trouver les moyens de s’adresser à tous au moment où, dans les faits, il en a l’occasion, soutiennent la nécessité d’une rénovation pédagogique. Loin de désespérer de la démocratisation, ils estiment que l’enseignement de la philosophie a assez de ressources en lui-même pour répondre à de défi, dont ils ne sous-estiment pas la difficulté ; leur choix de l’égalité (« la philosophie pour tous ») est éthique autant que politique.
Le sophisme conservateur
Alors qu’ils ne songent qu’à défendre les pratiques élitistes (la seule leçon comme modalités de cours, pas de travaux de groupes, pas d’exercices autre que la dissertation, etc.), les conservateurs se présentent comme défendant l’égalité. Leur raisonnement est le suivant :
- une réforme est démocratique quand un bien réservé à un petit nombre de privilégiés devient accessible à tous.
- la réforme pédagogique ne vise pas à offrir à tous l’enseignement traditionnel de la philosophie mais à le changer.
- donc la réforme pédagogique n’est pas démocratique (et il faut s’y opposer).
Le raisonnement joue de l’ambiguïté du terme « démocratique » dans le contexte scolaire. La « démocratisation » de l’école s’entend en effet en deux sens :
- la démocratisation sociale ou quantitative (on parle encore de démographisation ou communément de massification) ; elle correspond à l’élévation du taux d’accès aux différents niveaux de scolarisation et de certification de l’ensemble des classes d’âges. Il y a démocratisation sociale si la population accède en masse à l’école et à des niveaux de plus en plus élevés de la formation initiale. Elle a été réalisée dans les années 70-80.
- la démocratisation qualitative ; elle correspond à la réduction des inégalités entre catégories sociales dans l’accès aux différentes filières et diplômes ; elle est vérifiée si la réussite scolaire est de moins en moins dépendante des caractéristiques sociales des élèves. Ce qui est loin d’être le cas. [3]
Ces deux formes de démocratisation renvoient à des réformes bien différentes :
- la démocratisation quantitative (ou sociale) suppose des réformes structurelles ; ainsi l’accès du plus grand nombre au secondaire a été rendu possible par l’institution progressive de sa gratuité dans les années 30, le passage de l’obligation scolaire de 14 à 16 ans (1959), la création du collège unique (1975), etc.
- la démocratisation qualitative suppose des réformes pédagogiques et, en l’espèce, l’abandon des modalités élitistes d’enseignement homogènes au public du lycée des années 50-60.
Réformes structurelles et pédagogiques sont des également nécessaires de la démocratisation. Or, le sophisme conservateur consiste justement à les dissocier afin d’exclure toute réforme pédagogique. Comme l’écrit Jean-Jacques Rosat :
[On fait] comme s’il existait un modèle unique et universel de l’enseignement philosophique applicable à tous. En réalité, chacun le sait, ce modèle a une histoire : il a été construit il y a plus d’un siècle pour quelques milliers de lycéens issus de la bourgeoisie et destinés à constituer l’élite de la nation. Tant que l’on prétendra démocratiser l’enseignement de la philosophie en généralisant ce modèle et en se contentant de vouloir l’étendre à toutes les filières et à toutes les populations lycéennes, on risque plutôt de renforcer les discriminations sociales dans l’école et par l’école. [4]
Les conservateurs ont beau jeu de dénoncer l’échec de la démocratisation sociale (« on a ouvert le lycée à tous et voyez le résultat ») pour refuser la réforme pédagogique – jamais faite en philosophie – qui est l’autre condition d’une démocratisation réussie.
Conservateurs vs. progressistes ou républicains vs. démocrates ?
Dans leur opposition à la démocratisation de l’école, les conservateurs ont mobilisé successivement deux topoï :
- d’abord celui du couronnement contre les réformes structurelles de modernisation du système éducatif, de 1880 aux années 70.
- le topos républicain pour mobiliser la corporation contre les réformes pédagogiques des années 90 (rapport Derrida-Bouveresse en 90 et projet de programmes Beyssade en 1992, Renaut en 2001-2002).
L’opposition conservateurs / progressistes permet une meilleure description de la continuité du combat conservateur depuis 1880 que celle entre républicains et démocrates dont le thème n’apparaît qu’à partir de 1989 après le retour de la gauche au pouvoir et l’arrivée de Lionel Jospin au Ministère de l’Éducation.
La différence de contexte a son importance. Jusqu’aux années 60-70, la corporation défend le lycée élitiste traditionnel contre les réformes structurelles qui visent à le moderniser. La démocratisation réelle du second degré n’est pas à l’ordre du jour, même si elle se dessine. Ce n’est qu’une fois la démocratisation sociale devenue irréversible, à la fin des années 80, que les conservateurs – APPEP et l’Inspection générale de philosophie – se servent du topos républicain pour mobiliser la corporation contre les réformes pédagogiques. Parmi les protagonistes notables, citons Régis Debray (médiologue), Charles Coutel et Catherine Kintzler (de l’APPEP), l’universitaire Michel Fichant, qui tous les quatre appelleront à voter Jean-Pierre Chevènement aux présidentielles de 2002 contre Lionel Jospin, avec le succès que l’on sait. Le débat sur l’école est surdéterminé par la politique nationale. Les conservateurs partagent la même idée de l’école républicaine que celle de Jean-Michel Blanquer (dont ils ont acclamé l’arrivée au Ministère) et de Souâd Ayada (dont ils ont soutenu les réformes à la tête du Conseil supérieur des programmes).
On peut aisément mesurer, avec le recul, la médiocrité théorique et le grotesque politique de ce topos républicain. Il suffit de relire l’article à succès Régis Debray (grand rhétoricien) « êtes-vous démocrate ou républicain ? » publié dans le Nouvel Observateur en 1989 :
« La démocratie, dirons-nous, c’est ce qui reste d’une république quand on éteint les Lumières. »
« Le gouvernement démocratique tient que l’homme est un animal par essence productif, né pour fabriquer et échanger. »
« Les meilleurs en république vont au prétoire et au forum ; les meilleurs en démocratie font des affaires. »
« L’idée universelle régit la république. L’idée locale régit la démocratie. »
« "A chacun sa vérité", soupire le démocrate, pour qui il n’y a que des opinions. »
« La république aime l’école (et l’honore) ; la démocratie la redoute (et la néglige). »
« Il n’est pas de moyen plus sûr pour distinguer une république d’une démocratie que d’observer si la philosophie s’enseigne ou non au lycée, avant l’entrée à l’université. »
« Il est des républiques de nom, qui n’ont ni les principes ni les contraintes de la nôtre : ainsi l’Allemagne (…). L’Allemagne, le Japon, l’Italie sont des démocraties » [pourtant on enseigne la philosophie au lycée en Italie]
« Quand il parle en public, le républicain semble emphatique ou cassant. (…). Le démocrate est enjoué et piquant. (…) Le républicain est-il misogyne ? Et le démocrate androgyne ? Dangereux dans notre culture sont les poncifs sexuels. Mais éclairantes, les polarités. Disons alors que l’Homo republicanus a les défauts du masculin, l’Homo democraticus, les qualités du féminin. » [5]
Sur le plan pédagogique, cela ne vaut guère mieux. Dans le numéro de Janvier-Février 1989 de la revue de l’APPEP consacrée à « l’idée républicaine », Yves-Jean Harder explique que la démocratie est le « nivellement des individus », « l’homogénéisation des goûts et des besoins », « l’uniformisation des habitudes », « le règne de l’opinion et de l’argent », qu’il y a une antinomie entre république masquée par « l’expression malhonnête » de « République démocratique » ; l’analyse, dans ce même numéro, de l’Inspecteur Général Jacques Muglioni donne également le ton :
Il y a loin de la vertu républicaine d’égalité, qui doit être intraitable, à l’égalitarisme du ressentiment qui ne songe qu’à niveler, à couper tout ce qui dépasse, qui nie aussi bien la compétence que le mérite. Or, dans le langage convenu des pédagogues, on appelle précisément démocratique une école dans laquelle tend à s’effacer les inégalités, non pas sociale, mais de travail et de talent. (…) À la limite une école où l’on n’apprendrait plus rien serait, au sens dérisoire du mot, qui tend aujourd’hui à prévaloir, une école parfaitement démocratique.
Et Muglioni de dénoncer dans la foulée « le syndicalisme » qui prétend intervenir dans le débat public sur l’école :
le syndicalisme… relève de la société civile et n’a par suite aucun droit, d’ordre proprement politique, sur la conduite de l’État. En particulier il n’a aucune compétence sur l’école publique, la pédagogie et l’instruction des citoyens.
Ce à quoi le « démocrate » pourrait répondre : « et toi, Muglioni, qui es-tu pour décider qui a le droit ou pas d’intervenir dans les débats publics sur l’école ? ». [6]
Qu’est-ce que le rapport Derrida-Bouveresse ?
Dans le prolongement du rapport du Collège de France (Propositions pour l’enseignement de l’avenir) rendu par Pierre Bourdieu au Président de la République (François Mitterrand) en 1985, Lionel Jospin, alors ministre de l’Éducation nationale, réunit en décembre 1988, sous l’autorité de Pierre Bourdieu et de François Gros (biochimiste français, codécouvreur de l’ARN messager), dix groupes de réflexion sur les contenus d’enseignement dont la mission est de « procéder à une révision des savoirs enseignés en veillant à renforcer la cohérence et l’unité des savoirs ». Les responsables de ces groupes appartiennent aux différents champs disciplinaires ; ils publient ensemble, en avril 1989, un texte d’orientation : Principes pour une réflexion sur les contenus d’enseignement. Sur la base de ce texte, que diverses commissions spécialisées rédigent plus tard des propositions pour leur discipline. On appelle « Rapport Derrida-Bouveresse » le rapport rendu, fin, 89 à Lionel Jospin par la Commission de Philosophie et d’épistémologie, coprésidée par Jacques Bouveresse et Jacques Derrida.
Dès qu’il a vent de cette Commission de Philosophie et d’épistémologie confiée à Derrida et Bouveresse, Jean Lefranc, président de l’APPEP, fulmine :
L’un et l’autre ont écrit sur l’enseignement philosophique en France, ont porté des jugements tranchés et qui sont loin - très loin – d’être acceptés par l’ensemble des professeurs de philosophie. Jacques Derrida a aussi été le représentant le plus connu du GREPH (…) Quant à Jacques Bouveresse, il est l’auteur de Le philosophe chez les autophages, leur nomination apparaît bien (…) comme une provocation délibérée. [7]
Ce qui gêne le plus les conservateurs est que Bouveresse et Derrida ne sont pas des « pédagogues » mais des universitaires et des philosophes reconnus. « L’ennemi » est d’autant plus dangereux qu’il est intérieur, d’où la violence de leur opposition à partir de 1990.
Ainsi, le Rapport Derrida-Bouveresse reprenait la proposition du GREPH d’enseigner la philosophie dès la Première avant la Terminale. Il critiquait, au nom du principe de progressivité, l’absurdité pédagogique d’un enseignement, concentré sur une seule année, d’initiation mais aussi d’examen. C’est contre l’extension en Première, point névralgique, que les conservateurs (IG de philo et APPEP) ont concentré leurs attaques. Et ils pavoisent après le succès de leur entreprise. Jean Lefranc, président de l’APPEP n’hésite pas à écrire :
Le pire aura été évité : il n’est plus question de philosophie en Première ! [8]
Remercions-les, comme il convient, de ce triste exploit qu’ils réitèreront fin 2002 en obtenant l’abandon des programmes « Renaut ».
Que peut-on en retenir du rapport Derrida Bouveresse ?
Précisions d’abord que la commission Bouveresse-Derrida n’a jamais été chargée de rédiger des programmes mais seulement de formuler les propositions à partir d’un état des lieux soulignant les problèmes récurrents que révélaient par la correction des épreuves du baccalauréat et la situation critique de l’enseignement de la philosophie dans les séries techniques. Derrida et Bouveresse en concluaient à la nécessité d’assumer la dimension scolaire de l’enseignement, d’accepter le principe de sa progressivité, la nécessité de mieux spécifier et de clarifier les attentes, en revoyant les règles de l’examen et son lien avec les programmes.
Le Rapport énonçait quatre principes :
- premier principe : étendre l’enseignement de la philosophie en en amont et aval ;
- deuxième principe : associer plus étroitement la philosophie aux autres disciplines afin qu’elle contribue à l’unité et à la cohérence de la formation ;
- troisième principe : spécifier d’une manière bien plus rigoureuse les exigences à l’égard des élèves ;
- quatrième principe : penser enfin les problèmes spécifiques de l’enseignement de la philosophie dans le technique, où la situation est franchement inacceptable pour les enseignants comme pour les élèves.
Les deux premiers principes, inséparables, impliquaient une redéfinition de la relation de la philosophie aux autres disciplines, l’enjeu était clair : rompre avec la position de surplomb (le thème du « couronnement des études) et promouvoir à sa place une relation de collaboration avec les autres disciplines (et pas seulement les Lettres) qui permettent un travail interdisciplinaire dès la classe de Première.
Le 3ème principe débouchait sur des propositions de réorganisation des programmes et des épreuves du baccalauréat : revoir la conception des programmes si vagues qu’aucun professeur n’arrivait à couvrir en une année : moraliser l’épreuve du baccalauréat en clarifiant les règle de confection des sujets et en diversifiant davantage les épreuves.
Le 4ème principe débouchait sur cette proposition : « concevoir des modalités d’enseignement de la philosophie réellement appropriées aux élèves de l’enseignement technique ». Il s’appuyait sur les conséquences désastreuses de l’imposition, dans ces séries, du modèle d’enseignement par leçons-dissertations conçus pour les classes de l’enseignement général, où il était également difficile à tenir, au moins dans certaines classes. Peu de professeurs contesteraient, aujourd’hui encore, les constats du Rapport Derrida-Bouveresse :
L’indigence des copies de baccalauréat les rend inévaluables ; la plupart des élèves oscillent entre le découragement et le mépris, entre croire qu’ils ne sont pas capables de faire de la philosophie et juger qu’elle ne vaut pas une heure de peine ; les professeurs ont le sentiment qu’on leur assigne une mission impossible et de n’être pas en mesure tout simplement d’exercer leur métier. Certains en viennent à douter que l’enseignement de la philosophie ait un sens dans ces sections.
Quel est l’enjeu de la discussion sur la philosophie, « couronnement » des études ?
Pour le dire vite :
- la thèse du couronnement interdit de concevoir en philosophie une progressivité de l’enseignement, donc un cursus Première-Terminale ;
- la métaphore du couronnement est solidaire d’une conception conservatrice de l’école et de l’ordre social.
Commençons par donner quelques citations pour saisir - dans le texte - le sens et la portée de la métaphore du « couronnement ».
Elie Rabier, agrégé de philosophie, dans un discours de 1886 à l’occasion de la remise des prix du Concours général qu’il prononce en tant qu’Inspecteur d’Académie, en précise ainsi la double fonction :
La philosophie est appelée à rendre à la jeunesse ce double service : elle est un principe de force intellectuelle parce qu’elle complète et couronne les études scientifiques ; elle est un principe de force morale parce qu’elle complète et couronne les humanités. […] L’influence de la philosophie ne s’arrête pas à l’intelligence. C’est avec l’âme tout entière, suivant Platon, qu’il faut philosopher ; c’est l’âme tout entière que la philosophie, s’associant aux humanités, doit élever et agrandir. […] Là est la tâche sacrée de la philosophie. [9]
Élie Rabier [10], devenu Directeur de l’Enseignement Secondaire, réaffirme cette conception dans les Instructions pour l’enseignement philosophique de 1890 :
L’enseignement secondaire comprend, en effet, deux branches parallèles : les lettres et les sciences (…). Ces deux courants doivent aboutir à un terme unique qui est la philosophie. Elle est le couronnement des études et elle est la synthèse des lettres et des sciences. Par la psychologie et la morale, elle donne l’unité aux lettres ; par la logique et la métaphysique, elle donne l’unité aux sciences, le tout ramené à l’unité de l’esprit humain.
Nous retrouvons cette double fonction dans les "Instructions d’ Anatole de Monzie de 1925" : [11]
D’une part, [l’enseignement philosophique] permet aux jeunes gens de mieux saisir, par cet effort intellectuel d’un genre nouveau, la portée et la valeur des études mêmes, scientifiques et littéraires, qui les ont occupés jusque-là, et d’en opérer en quelque sorte la synthèse. D’autre part, au moment où ils vont quitter le lycée pour entrer dans la vie (…), il est bon qu’ils soient armés d’une méthode de réflexion et de quelques principes généraux de vie intellectuelle et morale qui les soutiennent dans cette existence nouvelle, qui fassent d’eux des hommes de métier capables de voir au-delà du métier, des citoyens capables d’exercer le jugement éclairé et indépendant que requiert notre société démocratique.
En 1961, c’est toujours cette conception que défend Louis-Marie Morfaux, au nom de l’APPEP qu’il préside :
Du point de vue intellectuel, la réflexion philosophique, qui se situe au point de convergence des humanités littéraires et scientifiques comme des humanités artistiques (…), en est le couronnement. (…) Elle n’est pas à proprement instruction mais éducation. C’est peut-être la prétention, en tout cas c’est l’ambition de l’enseignement de la philosophie d’aider nos élèves à être des hommes. (…)
Si la fonction du maître de philosophie est de faire prendre conscience aux jeunes gens de leur vocation et de leur destinée d’hommes, on ne voit pas quel autre maître pourrait le remplacer dans cet office. On ne voit pas non plus qu’à aucun de nos élèves on puisse refuser ce droit à la réflexion.
La pensée philosophique est, sans aucun doute, directement ou indirectement, la plus belle parure de la civilisation française, celle par laquelle notre nation garde dans le monde une place de premier rang. [sic] [12]
C’est aussi par cette fonction spirituelle (le « maître d’humanité ») que Georges Gusdorf justifie en fait le portrait en 1966 :
Le maître se passe de toute spécialisation et de tout professorat ; son influence joue comme un appel d’être, comme une interpellation adressée à tout un chacun. […] Enseigneur sans programme, professeur hors classe et sans traitement, Socrate se bornait à l’essentiel ; il était maître d’humanité.
C’est pourquoi la classe socratique de philosophie demeure en France, à juste titre, le couronnement de l’enseignement secondaire. [13]
L’histoire de notre enseignement oblige ici à préciser un point.
Quand Anatole de Monzie écrit que l’enseignement philosophique a pour vocation de former le citoyen que « requiert notre société démocratique », il ne parle que de « l’état-major » [14] de la démocratie, càd les 2,5% d’une classe d’âge qui ont accès au lycée en 1925. De même, quand Morfaux écrit « on ne voit pas non plus qu’à aucun de nos élèves on puisse refuser ce droit à la réflexion », il ne s’agit nullement d’affirmer - comme le fera le GREPH en 1975- le droit de tous à la philosophie mais seulement celui des 7% de « jeunes gens », cultivés et sélectionnés, qui fréquentent la classe de philosophie.
Le « Couronnement », expression des hiérarchies scolaires et sociales
Un point d’histoire est de nouveau nécessaire car la tendance des philosophes à essentialiser et mythifier « l’école républicaine » occulte ce qu’a été la réalité de l’enseignement de la philosophie, sa fonction sociale et sa mission politique : assurer la pérennité d’une république bourgeoise et bien-pensante (d’où l’importance du spiritualisme pendant longtemps en France).
1880-1960, la défense d’une école républicaine élitiste et inégalitaire.
Jusqu’aux années 60, l’école républicaine est structurée en ordres scolaires différenciés, aussi étanches et inégalitaires que pouvaient l’être les ordres de l’Ancien Régime. Les enfants du peuple n’ont pas les mêmes droits que ceux de la bourgeoisie. On distingue en effet :
- d’un côté l’ordre (ou réseau) primaire, gratuit, où vont les enfants du peuple dont la scolarité s’arrête au certificat d’études (à l’exception de la minorité qui poursuit dans le primaire supérieur pour faire l’équivalent d’un BEP) ; c’est bien l’école du peuple, l’école commune, la « communale », où l’on ne trouve ni bourgeois ni enseignement de la philosophie dans son degré supérieur.
- de l’autre, l’ordre (ou réseau) secondaire, payant, réservé aux enfants de la bourgeoise, qui vont d’abord dans les « petites classes » du Lycée (11ème, 10ème, 9ème 8ème, 7ème) puis au « lycée », de 6ème à la Terminale que couronne la classe de philosophie.
Primaire et Secondaire désignent deux ordres séparés, prenant chacun les enfants dont ils ont charge dès l’âge de 6 ans pour conduire les uns, ceux du peuple, au certificat d’étude, et, les autres, ceux de la bourgeoisie, jusqu’au baccalauréat naturellement. Chaque ordre a ses propres programmes, son propre corps d’enseignant (formés différemment), ses propres diplômes et ses propres finalités : le primaire doit donner un viatique à la masse (se contenter d’une instruction élémentaire à finalité utilitaire et civique) ; le secondaire doit éduquer les élites sociales en leur donnant une formation culturelle, morale et politique que « couronne » la philosophie. Ce n’est qu’au milieu des années 70 que le système scolaire achève son unification laborieuse, passant définitivement d’une école structurée en ordres à une école structurée en degrés : le 1er degré devenu « le primaire », et le 2nd degré, désormais le « secondaire », avec un 1er cycle, (« le collège »), un 2nd cycle (le « lycée ») et son supérieur (les classes préparatoires par exemple).
La nostalgie de l’école républicaine n’est en réalité que la nostalgie d’une société bourgeoise où le peuple était « à sa place », nostalgie d’un ordre inégalitaire fondé sur les distinctions sociales, naturalisées.
C’est bien cette école-là, et l’ordre social dont elle est solidaire, que défendent alors les « philosophes ». La profession s’est en effet constamment opposée tout au long du XXe siècle aux réformes visant à moderniser le système éducatif (en diversifiant ses filières) :
- opposition à la création d’une filière « moderne », scientifique, conduisant au baccalauréat – la classe de « Math. Elém. » (finalement créée en 1902 contre l’avis de la corporation)
- opposition réitérée de l’APPEP jusqu’en 1962 à la création de la classe de « Science Ex. », toujours pour diversifier les filières et adapter le lycée aux besoins d’un société qui se transformant rapidement
- opposée de l’APPEP à la création du baccalauréat de « sciences économiques et humaines » en 1953
- opposition de l’APPEP à la création des sections A, B, C, D, E, F, H, G et leurs baccalauréats respectifs (1965-1969)
- opposition de l’APPEP aux programmes de philosophie de 1973 (qu’elle considérera 10 ans plus tard comme la quintessence du philosophique).
- opposition de l’APPEP à l’institution d’un oral de rattrapage dont la note se substituerait à celle de l’écrit
- opposition à l’extension de la philosophie en Première
Ce qu’il faut bien comprendre c’est que la « métaphore du couronnement » solidarise :
- la défense corporatiste des bénéfices symboliques (leur influence dans l’institution scolaire) et des avantages (postes et conditions d’enseignement) que procure la position hégémonique de classe de philosophie du lycée traditionnel
- la défense d’une conception élitiste de l’école et de l’ordre social (comme on va le voir)
Toute réorganisation du secondaire remet, en effet, en question cette position hégémonique de la philosophie. Toute nouvelle filière signifie perte d’heures et de bataillons d’élèves pour la « classe de philosophie ». La diversification des filières entraîne aussi une modification de la hiérarchie : la philo est moins importante que les mathématiques dans une série scientifique ; ce qui le lot commun des disciplines est vécu comme un « déclassement » inacceptable par la corporation philosophique. Pire, on redoute que cette concurrence prive la classe de philosophie de ses meilleurs élèves. La métaphore du couronnement est alors stratégiquement opératoire pour défendre les intérêts corporatistes car s’il est vrai que l’essence de la philosophie exige que son enseignement couronne les études secondaires alors les réformes structurelles sont impossibles et le lycée doit éternellement rester ce qu’il était en 1900.
La démocratisation de l’école n’est pas vraiment le souci premier, on le voit, d’une corporation dont l’identité professionnelle a été dès l’origine associée à la formation des élites sociales et d’elles seules.
Si, en 1961, Louis-Marie Morfaux ne peut plus ignorer les aspirations démocratiques de la société française,
le principe est maintenant universellement admis que l’enseignement secondaire ne doit pas être l’apanage des enfants dont les parents sont plus ou moins des privilégiés de la fortune
il en précise aussitôt les limites quand il explique, à propos de la classe de Mathématiques, qu’elle
…est faite, comme toutes celles de l’enseignement secondaire, pour des élèves d’élite.
Il s’inquiète de la « dégradation » qui « menace la classe de Philosophie » et en ces termes :
les professeurs de sciences y déversent tous les sous-produits des Sections-Scientifiques (…) élèves médiocres qui auraient dû depuis longtemps être éliminés de l’enseignement secondaire. [15]
Nous sommes pourtant en 1961, rappelons-le : moins de 7% d’une classe d’âge accède à la classe de philosophie. Mais pour le président de l’APPEP c’est déjà excessif puisqu’il estime qu’il y a déjà trop de « sous-produits », d’« élèves médiocres » qui ne devraient pas y être et qui « auraient dû depuis longtemps être éliminés de l’enseignement secondaire ».
Ce n’est pas une déclaration isolée ou une maladresse mais l’ethos d’une corporation faite d’une catégorie de professeurs fonctionnaires, peu nombreux, à fort capital intellectuel, majoritairement des hommes, de formation homogène, enseignant une discipline culturellement prestigieuse et héritant d’une situation privilégiée, constituant une sorte d’aristocratie professionnelle au sein même du lycée. Par exemple, en 1961 encore, Suzanne Villeneuve (agrégée de philosophie) rappelle que la classe de philosophie n’a pas vocation à accueillir « des esprits de moindre qualité » que ceux des classes scientifiques ; accueillir le tout venant des élèves (du lycée élitiste bourgeois tout de même) serait transformer la classe de philosophie en une « classe-dépotoir » :
On dirige volontiers vers cette classe, les élèves qui n’ont ni aptitude ni goûts spéciaux : celui qui n’a pas « mordu » aux mathématiques, celui à qui la physique reste un domaine inaccessible (...) Nous refusons, quant à nous, cette justification de plus en plus répandue de la classe de philosophie, justification purement négative, qui consiste à dire : « tout le monde n’a pas suffisamment d’aptitudes poursuivre une classe scientifique » ; nous contestons que la classe de philosophie soit destinée à des esprits de moindre qualité ; elle représente une orientation différente, ce qui est tout autre chose. Car c’est ainsi qu’on s’achemine vers l’impression subtilement répandue d’une « classe au rabais », parfois même, on ose le dire, d’une « classe–dépotoir ». [16]
Le problème n’est pas la critique, après tout légitime, de modes d’orientation contestables mais bien cette idée très aristocratique que « des esprits de moindre qualité » peuvent bien être au lycée, si on ne peut l’empêcher, à condition que cela ne soit pas dans la classe de philosophie.
En 1966, l’APPEP déplore l’invasion de la Terminale par « des sujets médiocres ou peu doués » qui se serait produite, d’après elle, après la suppression de l’examen probatoire de 1ère. À l’en croire cette suppression :
…s’est automatiquement traduit par un abaissement sensible du niveau qualitatif de nos classes, les bons élèves se trouvant comme noyés dans une masse indistincte de sujets médiocres ou peu doués, dont la passivité autant que les faiblesses rendent particulièrement délicate et ingrate la tâche du professeur de philosophie. [17]
Le spectre d’une classe de philosophie « dépotoir » est là encore agité :
Les classes « littéraires » deviendront de ce fait des « refuges » pour les « autres ». On peut se demander comment la discipline qui exige la réflexion la plus difficile pourra s’accommoder d’être réservée aux plus médiocres. Cela ne peut aboutir qu’à une dénaturation profonde de l’enseignement philosophique. [18]
Cette conviction que la philosophie n’est pas faite pour tous les élèves, Joseph Moreau, l’exprime très clairement en 1969 :
La voie de l’instruction philosophique est donc simple, mais austère. Elle ne convient pas à un enseignement de masse. Mais la philosophie, en raison même de sa finalité humaine et de son intérêt universel, ne saurait être vulgarisée sans perdre son caractère, sans se dénaturer.
La classe de philosophie a longtemps été le couronnement des études classiques ; elle a été progressivement envahie et submergée par des éléments médiocres, venus des sections modernes, et qui se détournaient des mathématiques. [19]
Après 68, la profession se fracture –- sous l’influence aussi des mouvements philosophiques du temps : structuralisme, existentialisme, freudo-marxisme) ; mais pour les conservateurs rien ne doit changer en philosophie. Il en va de son « honneur » explique, en 1975, Gérard Pyguilhem dans la revue de l’APPEP :
Les combats pour l’honneur sont les seuls inévitables. Comment la philosophie échapperait-elle à cette loi, elle qui est responsable du couronnement des études secondaires en France et de cet honneur de la pensée qui est la vérité ? Car c’en est une, et des plus universelles, que celle de ce Bien, dont l’éveil de la présence illumine l’intelligence de tout être, en assure les démarches, éconduit, par fidélité à ce qu’il anime de profond et de cacher dans les âmes, aux plus belles floraisons. Cet amour du Bien, qui est la philosophie, ne saurait donc, en classe terminale, même optionnelle, se réduire à n’être qu’une discipline comme les autres, encore moins une spécialité. [20]
En 1984, l’Inspecteur Général Jean Lechat rappelle vigoureusement aux professeurs rêvant de collaboration interdisciplinaire en classe de 1ère que la philosophie, parce qu’elle doit couronner et synthétiser les savoirs, ne saurait se mêler aux autres disciplines, est rappelée par :
Elle n’est pas une discipline comme les autres (…). Elle ne se confond avec aucune science, et non pas comme une science se distingue d’une autre, parce que la somme des connaissances de tous ordres, démonstratives, expérimentales ou historiques, n’égale pas la philosophie ; la connaissance des premiers principes n’est contenue dans aucune science, même dans la plus certaine, ni dans l’addition de toutes. La philosophie ne peut entrer dans un projet d’interdisciplinarité qui en réalité tendrait à l’exclure en se substituant à sa fonction de synthèse, mais de manière clandestine et non problématique, donc tyrannique.
En vérité c’est la philosophie qui est l’interdisciplinarité elle-même (…) parce qu’elle permet une véritable réappropriation des savoirs acquis jusque-là extérieurement. (…) Elle est la visée de l’un et de l’universel. La fonction de l’enseignement philosophique est bien – et non exclusivement – de produire la prise de conscience des problèmes posés par les autres savoirs, et d’en rendre possible l’intelligence. [21]
La hantise de la confusion des disciplines est dans l’ordre scolaire l’analogue de la mixophobie dans l’ordre social. La philosophie doit couronner les études secondaires qui doivent rester le privilège des élites.
Le philosophe Edmond Goblot, se faisant pour le coup sociologue, expliquait sans fard les véritables enjeux de ces distinctions entre les ordres scolaires auxquelles tenant tant ses collègues quand ils s’opposaient à la création de la filière moderne, sans obligation du latin :
Qu’arriverait-il, en effet, si l’on pouvait faire des études secondaires sans latin ? Un élève intelligent et travailleur, en complétant ses études primaires élémentaires par l’école primaire supérieure ou même par un bon enseignement technique, pourrait être plus instruit et même plus cultivé que la moyenne des élèves de l’enseignement secondaire. (…) II n’y aurait plus cette inégalité de culture qui distingue les classes sociales ; tout serait confondu. Le bourgeois a besoin d’une instruction qui demeure inaccessible au peuple, qui lui soit fermée, qui soit la barrière. (…) Le baccalauréat, voilà la barrière sérieuse, la barrière officielle et garantie par l’État, qui défend contre l’invasion. [22]
Pourquoi les sociologues se mêlent-ils de nos questions ?
Précisons d’abord que personne n’a jamais soutenu qu’il appartenait aux sociologues de dire ce que doit être l’école (ou l’enseignement de la philosophie) même si, il faut le reconnaître, certains d’entre eux ne se privent pas de le faire, passant du descriptif au normatif.
La question est plutôt celle-ci : peut-on avoir une philosophie critique de l’enseignement de la philosophie qui ignore ce que l’histoire et la sociologie nous en apprennent - aussi ? Les progressistes répondent non. L’histoire et la sociologie nous délivre des mythes constitutifs de ce qu’il faut bien appeler l’idéologie corporatiste : mythique des origines, forcément héroïques (Socrate buvant la Cigüe), mythe Cavernicole du professeur descendant dans l’antre de l’Opinion, mythe de sa fonction politique éminente (la figure du philosophe Roi) et de sa grandiose mission civilisatrice (cf. plus haut J-L Morfaux), etc.
Pourquoi les professeurs de philosophie devraient-ils être se vexer de ce que la critique historique et sociologique nous invite à prendre en considération ? Voulons-nous nous bercer d’illusions ? Les apports de la sociologie et de l’histoire de l’éducation contribuent seulement à cultiver le jugement critique – éclairé par l’instruction - que nous exigeons communément des élèves. Dans la droite ligne de ce qu’écrivait Georges Canguilhem, en 1975, au moment des débats avec le GREPH, contre les éternels discours corporatistes de « défense de la philosophie » :
La philosophie n’a pas besoin de défenseurs, dans la mesure où sa justification est son affaire propre. Mais la défense de l’enseignement de la philosophie aurait besoin d’une philosophie critique de l’enseignement. [23]
Nous avons déjà vu comment l’histoire et la sociologie font justice de ce mythe d’une école républicaine égalitaire et d’un enseignement de philosophie ordonné à l’émancipation de l’homme commun. Donnons deux autres exemples.
« Le complexe de la citadelle assiégée »
L’école républicaine occupe une grande place dans notre imaginaire professionnel et cela se comprend. Supprimé en 1852, sous Napoléon III, rétabli par Victor Duruy en 1863, délivré en 1880 d’avoir à enseigner une philosophie d’État (celle de Victor Cousin) l’enseignement de la philosophie en a hérité une méfiance maladive envers l’État (toujours suspecté de vouloir le bâillonner) et une reconnaissance éternelle à la république.
Sauf que les conservateurs n’ont cessé d’abuser de cette mémoire traumatique pour ameuter les professeurs contre la moindre réforme sans le moindre examen rationnel le contenu. Rappelons par exemple que le Rapport Derrida-Bouveresse n’a jamais été publié ni diffusé ; les collègues en ont donc jugé que d’après la plaquette guerrière de l’APPEP, véritable libelle de désinformation. Notre collègue Sébastien Charbonnier a bien analysé les effets de cette mémoire traumatique liée à l’histoire de notre discipline :
Le spectre d’une possible disparition hantera les esprits et engendrera souvent de la mauvaise foi dans la réception des critiques qui pourront être adressées à l’enseignement de la philosophie. (…) Critiquer les attaques contre l’enseignement comme service public (…) ne doit pas laisser ignorer ce qui a été réactionnaire dans cet enseignement (dont on ne saurait regarder le passé comme un âge d’or révolu). De fait, la peur de voir mourir la philosophie a provoqué un frein objectif à la capacité d’écoute des critiques, aussitôt assimilées à une menace. [24]
Jacques Bouveresse relevait également l’irrationalité de ces défenses et illustrations de la philosophie :
Dans le discours apologétique plus ou moins rituel qui est censé avoir pour but de la défendre contre ses critiques et ses ennemis, la philosophie est remplacée, en réalité, le plus souvent par une sorte de philo-philosophie. Ce qui est proposé n’est pas un plaidoyer rationnel en faveur de la philosophie, mais plutôt une incitation à l’amour de la philosophie et une condamnation plus ou moins morale d’une « haine de la philosophie » supposée, qui est considérée en fin de compte comme la seule explication possible des réticences et des résistances auxquelles se heurtent les activités et les productions des philosophes. [25]
C’est malheureusement sans succès que Jean Jacques Rosat, alors professeur en Lycée technique et do-signataire du rapport Bouveresse-Derrida, invitait ses collègues à se déprendre des fantômes du passé :
Ne nous trompons pas d’époque, personne ne veut aujourd’hui la mort de notre enseignement. Le complexe de la citadelle philosophique assiégée par les technocrates et les sciences humaines hante encore trop d’imaginations. Un public nouveau est entré dans nos classes et ne va cesser d’y affluer. Faisons la preuve de la vitalité de notre enseignement en réfléchissant ensemble sérieusement aux conditions dans lesquelles nous pourrons lui donner les moyens de faire vraiment de la philosophie. [26]
Suivons encore le conseil de Sébastien Charbonnier, ouvrons-les yeux sur « ce qui a été réactionnaire » dans notre enseignement ».
Des professeurs-philosophes, « chiens de garde » de la société bourgeoise ?
L’école de la IIIème République est, on l’a vu, une école de classe. Et c’est bien aux professeurs de philosophie qu’échoient la défense de cet ordre social et inégalitaire de la république conservatrice. C’est même un sacerdoce. Lisons par exemple ce qu’écrit le très influent Alfred Fouillée, agrégé de philosophie, maître de conférences à l’École Normale Supérieure, à propos de la différence de destination scolaire des élites et du peuple :
Les études libérales sont celles qui ont pour but de former une élite éclairée, songeant à l’avenir, préposée à la sauvegarde des grands intérêts intellectuels ou moraux et, en un mot, de l’esprit national. Le principal danger des démocraties, c’est l’excès de la tendance utilitaire, qui agit en vue des besoins les plus rapprochés et des résultats les plus visibles. La majeure partie d’un peuple est composée d’hommes préoccupés de l’intérêt présent et personnel, puisqu’ils n’ont ni assez de ressources matérielles, ni assez de culture intellectuelle pour agir en vue d’intérêts lointains et généraux. Un certain utilitarisme est d’ailleurs pour ceux-là une nécessité, presque un devoir. Il y a au contraire un ensemble d’hommes, non pas plus méritants, mais plus fortunés, que leur situation sociale et leur culture intellectuelle rendent capables, même indépendamment de toute moralité supérieure, d’oublier l’intérêt immédiat en vue d’un but plus lointain ou, ce qui est mieux encore, d’un but national et même humain. Ce sont ceux qui ne sont obligés ni de vivre au jour le jour, ni de penser et agir au jour le jour. Que ceux-là, en échange de leurs avantages et de leur situation privilégiée, aient pour obligation stricte de prendre en main l’intérêt du peuple entier, cela est de toute évidence. Si la direction de notre corps s’impose aux cellules cérébrales du cerveau, non à celles de l’estomac, c’est que les premières peuvent agir pour des utilités lointaines et même impersonnelles, tandis que la cellule de l’estomac ne connaît qu’un devoir : absorber sur le moment le liquide nourricier dont elle a besoin. Au cerveau de la nation appartient l’honneur et incombe la tâche, surtout dans les périodes critiques, de représenter et de faire prévaloir les plus hautes pensées directrices et les plus hautes volontés de la patrie. (…)
Les études classiques restent l’unique moyen d’entretenir au sein de la France l’élite d’esprits élevés et désintéressés, par cela même l’atmosphère de moralité supérieure sans laquelle une démocratie se rue à la démagogie. (…) Il n’y a pas de vraies études secondaires sans le couronnement d’une philosophie sérieuse et complète. [27]
Conception que l’on retrouve explicitement dans les Instructions sur l’enseignement philosophique de 1880 :
Il prépare aux carrières les plus importantes de la société, et dans chacune de ces carrières il forme l’élite (…) tous ceux qui seront à la tête de la société.
Que l’enseignement de la philosophie soit sa nature idéologique ou cléricale, point de doute. Lisons encore Alfred Fouillée :
La philosophie est la religion publique des démocraties, et nous avouons que nous n’aurions pas grande confiance dans l’avenir d’une république sans philosophie. Si prêtre et roi vont bien ensemble, toujours aussi on a rapproché ces deux titres : philosophe et citoyen. [28]
Non seulement l’enseignement de la philosophie se substitue à la religion, mais il doit lui emprunter ses moyens :
Selon Platon, point de pratique sans quelque magie […]. Les religions le savent bien, l’éducation moderne ne s’en souvient pas assez. Si l’éducation cesse d’être religieuse, il faut qu’elle trouve ailleurs de quoi fasciner, entraîner, enthousiasmer les âmes. A la magie de l’imagination il faut substituer celle des grandes idées universelles et des grands sentiments humains. […] De même que la force de l’enseignement catholique venait de ce que tous les professeurs étaient des prêtres et, à ce titre, des moralistes, des directeurs de conscience bons ou mauvais, de même l’enseignement secondaire laïque aurait une force irrésistible s’il était donné par des philosophes, se considérant eux-mêmes plus ou moins comme des prêtres de la société nouvelle fondée sur l’union des libres esprits. [29]
Paul Nizan avait-il raison ? Dans Les chiens de garde, Paul Nizan mène la charge contre la neutralité politique prétendue de ces philosophes désengagés qui servent, en réalité et avant tout, les intérêts de la bourgeoisie (la critique s’appliquerait de même aux associations conservatrices se prétendant neutres et apolitiques comme l’universel). Il est difficile de lui donner tort si on confronte le prétendu repli des philosophes dans le Ciel incorruptible des idées pures à la réalité historique, parfaitement documentée. De nouveau, Alfred Fouillée :
L’école publique n’est point faite pour seconder l’ambition des pères et mères qui veulent soustraire leur progéniture au travail manuel, pour créer de nouveaux aspirants aux emplois du gouvernement. Elle est faite pour préparer à la société des hommes honnêtes et capables d’honorer la profession même la plus humble ; ce qui n’empêche pas de laisser tous les escaliers accessibles à ceux que leurs capacités exceptionnelles désignent pour monter plus haut. On se plaint sans cesse des éléments de démoralisation dûs à la multiplication des déclassés de tout ordre (…) Quand nous disons : « Point de déclassés », voulons-nous dire qu’il ne faille pas instruire le peuple ou la petite bourgeoisie ? Loin de là : il faut instruire chacun le plus possible. Mais non pas tous de la même manière, ni par des méthodes qui produisent finalement un manque d’adaptation de l’enfant à sa condition future. (…) C’est ce genre de déclassement qui est dangereux pour la moralité d’une nation, plus dangereux encore dans une démocratie, et que l’enseignement moderne mal compris va multiplier. [30]
Maintenons donc la hiérarchie naturelle au lieu de poursuivre un nivellement factice, qui ne peut s’obtenir que par l’universel abaissement (…). La démocratie bien entendue ne consiste pas à supprimer et à niveler toutes les différences d’instruction et d’éducation (…). Il est dangereux, surtout dans une république (…) d’y supprimer les degrés de la hiérarchie, d’y faire s’évanouir l’élite (…) Tout n’est pas absurde dans le « préjugé bourgeois » dont on se moque tant aujourd’hui. Le philosophe qui ne se laisse pas prendre aux apparences y reconnaîtra une sorte d’instinct très légitime. [31]
Ce qui frappe chez les républicains conservateurs c’est la permanence du schème sacerdotal chez les républicains d’Alfred Fouillée à Régis Debray :
- Alfred Fouillée :
Si une démocratie n’est pas religieuse comme le fut la cité antique (lisez Fustel de Coulanges), il faut qu’elle soit philosophique ; il faut, sous une forme ou sous qu’elle vive d’une vie spirituelle et morale. La France a besoin d’une conscience morale, qui ne peut elle-même exister sans une conscience intellectuelle, sans des principes de jugement et d’action dégagés par la réflexion. Or la réflexion sur les principes ne peut être que philosophique ; elle est la philosophie même, par définition. (…). Sans doute un peuple où tout le monde irait à la messe et à confesse pourrait se dispenser de réfléchir et de philosopher ; mais, comme le Gouvernement ne peut plus exiger de billets de confession, ni surtout la foi à la confession, nous sommes obligés de chercher un point d’appui tout rationnel pour la vie des sociétés modernes. (…) La philosophie n’est pas une paroisse. Elle est le temple universel. [32]
- Régis Debray :
En laissant s’évanouir son sacré républicain, la France s’effiloche en communautés, chacune d’elle cultivant ses sacralités propres. [33]
On se prend à penser que la République aura un avenir plus assuré du jour où un chef de l’État osera évoquer à voix haute, du haut d’une tribune, non de sempiternelles valeurs en carton-pâte, mais un sacré remis à neuf, effrontément laïque et courageusement déplacé. [34]
Qu’est-ce donc que le "danger de la pédagogie" ?
Les diatribes conservatrices contre la pédagogie ne peuvent être comprises que resituées dans leur le contexte historique. Avant 68, la pédagogie n’est l’objet d’aucun anathème comme en témoignent les nombreux articles publiés dans la revue de l’APPEP. Après 68, la contestation du cours magistral, l’apparition de nouvelles pratiques (travaux de groupes, enquêtes, l’ouverture aux sciences humaines, etc.) les conservateurs se raidissent. L’association professionnelle ne publie pratiquement plus d’articles pédagogiques et l’Inspection Générale coupe court à toutes ces innovations. Doyen de l’Inspection générale philosophie, Jacques Muglioni impose le retour à la « leçon parlée » et à la dissertation comme seule exercice, un retour à 1880 en somme. C’est le tournant « philosophiste » bien analysé par Francis Marchal. [35]
Ce raidissement se produit quand la gauche, arrivée au pouvoir, met la réforme pédagogique du lycée à son agenda. Le Ministère d’Alain Savary s’allie avec les pédagogues issus de la contre-culture issue de 68, ce qui donne à l’orientation réformiste des années 81-85 une coloration particulière :
- critique de la culture scolaire réputée élitiste, de la pédagogie traditionnelle (transmissive), autoritaire (cf. Jean Houssaye, Autorité ou éducation ?) et de l’école-caserne, d’une école qui éteint la spontanéité, la créativité des élèves, etc.
- promotion d’un technicisme pédagogique censé valoir par lui-même en raison de son efficacité, s’inspirant largement de la pédagogie de la maîtrise de Benjamin Bloom.
La période 81-84 scelle l’alliance entre le politique et le pédagogue, un pédagogue anti-culturel et anti-scolaire. La réaction est vive, et pas seulement en philosophie.
En 1989, la configuration est nouvelle : Le politique s’appuie sur des savants reconnus dans leur champ disciplinaire. C’est à Jacques Bouveresse et Jacques Derrida qu’est confié la mission de réflexion sur l’enseignement de la philosophie. Et cela restera vrai ensuite des tentatives ultérieures (Jean-Marie Beyssade en 1992 ; Alain Renaut en 2001-2002).
Il s’agit de mettre en œuvre ce que Bourdieu appelle une « pédagogie rationnelle ». La pédagogie que requiert une école démocratique n’est pas celle tournant le dos eu scolaire et renonçant renoncer à la culture, mais celle qui n’ignore pas les mécanismes liés au capital culturel qui fabriquent et amplifient les inégalités scolaires ; car c’est bien quand l’action pédagogique fait la part belle à l’implicite, aux acquis familiaux et dévalorisent tout ce qui est scolaire que les inégalités se creusent.
Pour les progressistes il n’y a donc pas à choisir entre une culture classique élitiste prônant le rejet de la pédagogie et une culture pédagogique prônant le renoncement aux enseignements de culture. C’est bien une troisième voie renvoyant dos-à-dos les pôles du débat antérieur : culture humaniste élitiste vs. contre-culture pédagogique, philosophe vs. pédagogue, Muglioni vs. De Peretti, Kambouchner vs. Meirieu.
Les professeurs - pédagogues parce que quelque peu sociologues- désireux de sortir de cette querelle créent en 1998 une nouvelle association professionnelle, l’ACIREPh (aussitôt accusée par les conservateurs d’être du côté des « pédagogues »).
Et pourquoi la philosophie ne serait-elle pas elle-même sa propre pédagogie ?
L’affirmation du caractère auto-pédagogique de la philosophie n’est qu’un slogan inventé par les conservateurs et dont l’unique objectif est de maintenir les caractéristiques pédagogiques de l’enseignement philosophique traditionnel, de fait élitaire et anti-démocratique.
La thèse conservatrice est la suivante : il y a bien une pédagogie de la philosophie, c’est la philosophie elle-même. [36] Comme dit Jacques Muglioni :
Lorsqu’il s’agit d’apprendre à enseigner la philosophie […] il faut d’abord que le professeur soit en quelque façon un philosophe, car c’est la maîtrise du contenu, et elle seule, qui peut lui assurer une audience philosophique (..) Il est, en effet beaucoup plus difficile d’approfondir directement le contenu substantiel et de philosopher soi-même que de s’adonner aux activités conviviales aujourd’hui tant vantées sous le titre d’animation pédagogique. [37]
Jean-Luc Marion renchérit :
Pour que Socrate reste fonctionnaire, il faut qu’il prouve qu’il est bien Socrate. [38]
Mais comment opère l’efficace du Professeur-Philosophe ? Par la Leçon du Maître, explique Muglioni :
Suivant ainsi le cours magistral, si du moins le maître est un vrai maître, l’élève se hausse jusqu’à retrouver les sources premières d’une pensée qui ne se présente pas comme ayant déjà été pensée, mais qui se forme devant lui, avec lui, en lui. C’est pourquoi dans la meilleure leçon l’élève n’a pas besoin d’être interrogé nommément pour répondre, voire pour interroger lui-même et soulever les objections. II se sent intérieurement sollicité et répond ou objecte exactement à la place du maître, témoignant ainsi qu’il acquiert lui-même la maîtrise de la pensée. […] [39]
Pour les conservateurs, le professeur de philosophie a, comme philosophe excellent, tout ce dont il a besoin pour être un excellent pédagogue. C’est uniquement l’enseignant médiocre qui réclamerait une formation pédagogique, des conseils pratiques pour organiser son cours, souhaiterait échanger des idées et partager des façons de faire avec ses collègues.
On comprend mieux pourquoi Christiane Menasseyre, Inspectrice Générale et future Doyenne de l’inspection, peut déclarer :
Nous disons tous ici : nous ne savons pas ce qu’est la pédagogie en philosophie (…) : il n’y a pas d’exigence professionnelle, il n’y a d’exigence pédagogique, en philosophie, que philosophique. [40]
En 1984, Bernard Bourgeois, académicien philosophe, président du jury d’agrégation- qui a vu un élève de lycée pour la dernière fois en 1963 - en est certain :
La solution du problème pédagogique n’est pas proprement pédagogique. C’est bien le contenu enseigné qui est le pédagogue primordial. Aussi, former le futur maître, c’est instruire l’élève qu’il est d’abord. [41]
Avec ce zeste d’esthétisme aristocratique qui sied si bien aux conservateurs, Jacques Muglioni, précise :
Le comble de la vulgarité en pédagogie, c’est le souci d’intéresser. [42]
Et l’Inspecteur Général de tonner si quiconque ose questionner le dogme anti-pédagique :
Nous n’avons pas le droit de ne pas être d’accord [sic] sur ce qu’est et sur ce que poursuit l’enseignement philosophique (…) Osons dire que le doute, méthode philosophique par excellence, ne vaut rien en pédagogie, qui n’est pas d’ordre spéculatif mais directement pratique. On interroge sur des questions ; l’enseignement n’est pas une question, mais une fonction. Et nul n’est obligé de la remplir. [43]
En clair : les professeurs qui pensent que la pédagogie est nécessaire peuvent prendre la porte. Et on les y aidera si nécessaire.
Le déni pédagogique et déni sociologique font corps dans la doctrine conservatrice. Sans la moindre ironie que l’Inspecteur Général Léon-Louis Grateloup écrit dans une « Notice pédagogique à l’usage du professeur de philosophie en terminale » (les collègues apprécieront) :
Au lycée, les conditions socioéconomiques jouent ce rôle de facteurs exogènes, qui tendent à redevenir prépondérants dès qu’on s’avise de les prendre en compte et qui réduisent à rien la part du philosophique lorsque le pédagogique est appelé à prévaloir. La classe de philosophie est un lieu où les réalités de l’existence quotidienne flottent en état d’apesanteur sociologique. La classe de philosophie est le seul modèle visible d’une cité idéale. [44]
Dans la même veine, Jean Svagelski, IPR à Dijon, admet que l’enseignement de la philosophie s’adresse de plus en plus souvent à des élèves issus des classes populaires… :
dont on entend dire qu’ils sont culturellement défavorisés bien qu’on ne voie pas le rapport de cause à effet, et que par conséquent l’intelligibilité de cette affirmation soit nulle. [45]
Documents joints
Rapport dit "Derrida-Bouveresse"
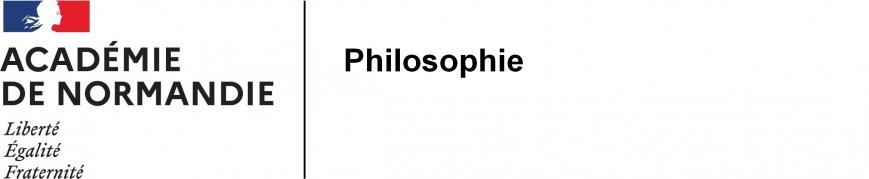
Répondre à cet article
Suivre les commentaires : |
|
